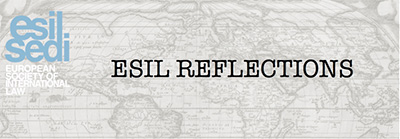Newsletter de la SEDI – Été 2025
Éditrice: Ana Salinas (Universidad de Málaga)
Dans ce numéro
Rencontre avec une membre de la SEDI – Heike Krieger
Nouvelles de groupes de réflexion
1. Message du Président

Chères et chers membres de la SEDI,
L’été approche à grands pas, et avec lui, l’espoir d’un temps de pause, propice à la réflexion et aux moments partagés avec vos proches. Dans mes précédentes lettres, j’ai souvent fait référence à ce que le Forum de recherche de Catane a qualifié de «permacrise», une notion qui semble capturer l’esprit de notre époque. Nous faisons face à une succession de défis — conflits géopolitiques, urgence climatique, bouleversements technologiques — qui s’enchaînent sans répit.
Jeune, je croyais que ces turbulences étaient cycliques: chaque génération affrontant ses propres secousses. Mais je suis de plus en plus convaincu que ces périodes sont marquées par des défis inédits, qui méritent une attention spécifique.
Dans ce contexte, tant à l’intérieur qu’au-delà du champ du droit international, un sentiment de fatigue collective nous gagne parfois — une forme d’épuisement face à l’obligation constante de naviguer entre les failles d’un ordre international fragilisé. L’été, même bref, nous offre l’occasion précieuse de prendre du recul. Ce temps de respiration peut aussi nous permettre de nous recentrer sur le thème de notre prochaine conférence annuelle de l’ESIL à Berlin: Reconstruire le droit international.
Cette idée de «reconstruction» va bien au-delà d’un simple intitulé destiné à attirer l’attention. Elle constitue un véritable appel à l’action pour notre communauté. Parler de reconstruction, c’est nous inviter à dépasser la posture d’observation, de narration ou même de résistance face à la crise. C’est un encouragement à nous engager dans le travail rigoureux, minutieux, et résolument tourné vers l’avenir, que cette tâche implique.
Reconstruire, c’est faire des choix assumés. C’est reconnaître nos rôles situés, parfois éloignés de l’universalité que nous revendiquons, tout en affirmant nos idéaux avec courage et en acceptant la confrontation avec d’autres voix. Cela demande aussi de franchir les cloisonnements disciplinaires — et même ceux au sein de notre propre discipline — pour passer de la critique à l’engagement. Cela suppose enfin d’accepter nos doutes et nos peurs, sans pour autant renoncer au potentiel immense de l’action collective.
Le droit international reste pour certains une discipline imparfaite, pour d’autres un rempart de rationalité face aux dynamiques du pouvoir. Quelles que soient nos sensibilités, je suis convaincu que nous, chercheurs et chercheuses, avons la capacité de réfléchir ensemble à ce que le droit international peut — et doit — devenir pour affronter les défis urgents d’aujourd’hui et de demain.
Ces défis sont nombreux, certes. Mais peut-être peuvent-ils aussi devenir sources d’inspiration. Nous avons l’opportunité de nous emparer des enjeux transnationaux générés par les avancées scientifiques et technologiques, et la responsabilité de repenser nos cadres juridiques et éthiques pour mieux répondre aux préjudices nouveaux, qu’ils soient causés par l’humanité ou par les forces naturelles. La vulnérabilité, la peur et la souffrance restent le quotidien de trop de personnes à travers le monde. Le droit international ne saurait, à lui seul, y remédier. Mais il peut — et doit — être un outil au service de la réparation. À nous d’imaginer comment.
Les sessions, panels et échanges informels à Berlin ne seront pas de simples discussions académiques. Ils peuvent devenir des creusets intellectuels, des lieux où poser les premières pierres de cette reconstruction. Pour cela, il nous faut du courage intellectuel, une disposition à remettre en question des certitudes bien établies, et la volonté d’entrer dans un dialogue exigeant. Et c’est bien ce dialogue qu’il nous faut préserver. La solidarité professionnelle, que je n’ai cessé de défendre, n’est pas qu’une marque de courtoisie: elle est la condition première de toute démarche créative et critique.
À l’heure où je vous adresse ce dernier éditorial en tant que Président de l’ESIL, je souhaite vous laisser avec une question: et si notre communauté de juristes internationalistes pouvait aller au-delà d’une simple gestion des crises pour embrasser un nouveau projet intellectuel, plus proactif — celui de la reconstruction?
Nous avons tout pour y parvenir. Grâce à la diversité de nos regards, à la richesse de notre expertise collective, et surtout à notre engagement commun à penser le droit international, nous avons une contribution précieuse à apporter — en tant qu’universitaires, en tant que juristes, en tant qu’internationalistes. Accueillons ensemble, à Berlin, cet appel à la reconstruction.
Avec tout mon dévouement,
Gleider Hernández, Président de la SEDI
2. Editorial de l’invitée par Serena Forlati: Les mesures provisoires de la CIJ dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël: un exercice futile?

Il y a un peu plus d’un an, la Cour internationale de justice (CIJ) rendait la dernière de ses trois ordonnances de mesures conservatoires dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël.[1] L’affaire, fondée sur l’article IX de la Convention sur le génocide, stipule notamment qu’Israël «doit, … en ce qui concerne les Palestiniens à Gaza, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission» d’actes génocidaires[2] et «veiller à ce que son armée ne les commette pas»;[3] qu’il doit «prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de garantir… la fourniture sans entrave et à grande échelle par toutes les parties concernées de services de base et d’une aide humanitaire d’urgence», notamment en ouvrant les points de passage frontaliers;[4] et qu’il doit «cesser immédiatement son offensive militaire, ainsi que toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, qui pourrait imposer au groupe palestinien de Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle».[5]
Toute évaluation formelle quant à une violation de ces mesures, ou concernant les allégations d’infraction à la Convention sur le génocide par Israël, relève du fond.[6] Néanmoins, dès mars 2024, il était difficile de nier que la situation dramatique à Gaza « n’aurait probablement pas existé si l’ordonnance du 26 janvier 2024 avait été pleinement mise en œuvre»[7] Aujourd’hui, la situation humanitaire dépasse les mots : des otages israéliens restent entre les mains du Hamas ; aucune solution politique ne se profile ; et une nouvelle guerre ouverte entre Israël et l’Iran complique encore davantage la situation.
Plutôt que de se pencher sur l’article 94 de la Charte des Nations Unies ou sur d’autres mécanismes d’application des décisions de la CIJ, on repense aux mises en garde du juge Xue dans l’affaire relative aux Allégations de génocide, concernant les mesures conservatoires en contexte de conflit armé,[8] et une question plus fondamentale se pose : l’exercice de la fonction judiciaire dans de telles circonstances est-il réellement vain ? On peut soutenir que la réponse est non.
Le cadre juridique et politique de la crise de Gaza est d’une extrême complexité. Les États occidentaux – qui ont fermement condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie – se sont jusqu’à présent montrés bien plus réservés quant à la nécessité pour Israël de respecter ses obligations en droit international, notamment celles découlant des ordonnances. Même le débat académique est difficile,[9] n particulier parce que toute accusation de violation de la Convention contre le génocide par Israël est hautement sensible.[10] Dans ce contexte, une évaluation impartiale – même à titre préliminaire – de la situation à Gaza, ainsi que la définition d’obligations claires et précises à l’égard d’Israël, jouent un rôle important, fût-il indirect. Les États, dans toutes leurs ramifications – y compris les universités et les institutions de recherche publiques – peuvent s’appuyer sur ces décisions pour évaluer leurs propres obligations de diligence en matière de prévention et de cessation des atrocités de masse. En outre, ces ordonnances offrent un socle plus solide à l’action de la société civile, y compris de celles et ceux en Israël qui ne soutiennent pas la voie suivie par leur gouvernement.
Si l’idéal d’un ordre juridique international devait survivre à ce qui est aujourd’hui le cimetière physique et métaphorique de Gaza,[11] ce serait aussi grâce à l’exercice par la CIJ de son pouvoir d’adopter des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 de son Statut.
[1] ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Orders of 26 January, 28 March and 24 May 2024.
[2] Order of 26 January 2024, para. 86(1). On the binding nature of provisional measures see ibid., para. 83.
[3] Ibid., para. 86(2).
[4] Order of 28 March 2024, para. 51(2)(a). See also the Order of 24 May, para. 57(2)(b).
[5] Ibid., para. 57(2)(a).
[6] Order of 26 January 2024, para. 62.
[7] South Africa v. Israel, Separate Opinion of Judge Nolte, appended to the Order of 28 March, para. 4.
[8] Allegations of Genocide (Ukraine v. The Russian Federation), ICJ Reports 2022, p. 241, para. 6: “[I]n the context of an armed conflict, one may wonder how those provisional measures can be meaningfully and effectively implemented by only one party to the conflict. When the situation on the ground requires urgent and serious negotiations of the Parties to the conflict for a speedy settlement, the impact of this Order remains to be seen”.
[9] See Sué González Hauck, Isabel Lischewski, “Closing Channels”, Völkerrechtsblog, 26 July 2024. The difficulty of fostering a serious academic debate is certainly not limited to Germany.
[10] See only the opening statement of Israel’s Deputy Agent, Becker, at the hearing of 12 January 2024, paras 1-11.
[11] Itamar Mann, “In the Graveyard of International Law”, Verfassungsblog, 16 May 2025.
3. Rencontre avec une membre de la SEDI – Heike Krieger
 Rencontrez Heike Krieger, professeure de droit international public à la Freie Universität Berlin et membre de l’équipe locale d’organisation de la conférence annuelle 2025 de la Société européenne de droit international (SEDI) à Berlin
Rencontrez Heike Krieger, professeure de droit international public à la Freie Universität Berlin et membre de l’équipe locale d’organisation de la conférence annuelle 2025 de la Société européenne de droit international (SEDI) à Berlin
4. Quelles nouvelles?

20e conférence annuelle de la SEDI à Berlin – Reconstruire le droit international
La 20ᵉ Conférence annuelle approche à grands pas – elle se tiendra du 11 au 13 septembre 2025 à la Freie Universität Berlin.
Veuillez consulter le site www.esil2025.de pour découvrir le programme complet et accéder à la plateforme d’inscription. Les inscriptions affluent – alors n’attendez plus pour vous inscrire, afin de ne pas manquer la conférence de Berlin. Tous les billets pour le dîner de la conférence sont déjà épuisés, et la conférence sera bientôt complète elle aussi.
Nous remercions chaleureusement la communauté de la SEDI pour son intérêt exceptionnel à venir à Berlin afin de débattre, réfléchir et penser ensemble la reconstruction du droit international.
Helmut Aust & Heike Krieger

Forum de recherche SEDI 2026 – Un droit international durable. Réconcilier stabilité et changement
Le Forum de recherche 2026 de la SEDI, qui se tiendra les 9 et 10 avril 2026 à Cracovie, sera accueilli par le Centre d’études avancées sur la durabilité et l’Université Jagellonne.
Ce forum unique vise à encourager des échanges riches autour du thème « Un droit international durable. Réconcilier stabilité et changement ». Il explorera en profondeur comment le droit international peut préserver la sécurité juridique tout en régulant efficacement les transformations sociales, économiques et environnementales de notre monde instable.
Pour plus d’informations sur le Forum de recherche SEDI 2026 et pour consulter l’appel à contributions (date limite de candidature : 30 septembre 2025 à 12h00 CEST), rendez-vous sur https://esil.cass.science.
5. ESIL Lectures
 La Série de Conférences SEDI diffuse des présentations sur des sujets de droit international organisées par des institutions partenaires, permettant ainsi à ces interventions de toucher un public plus large, composé de membres et non-membres de la SEDI.
La Série de Conférences SEDI diffuse des présentations sur des sujets de droit international organisées par des institutions partenaires, permettant ainsi à ces interventions de toucher un public plus large, composé de membres et non-membres de la SEDI.
Les conférences de la SEDI sont disponibles sur le site web de la SEDI ainsi que sur la chaîne YouTube de la SEDI.
Pour proposer une conférence SEDI, veuillez consulter les lignes directrices de la série de conférences SEDI.
6. ESIL Proceedings
Les ESIL Proceedings présentent les contributions présentées lors des événements organisés par la Société européenne de droit international (SEDI), tels que les conférences annuelles, les forums de recherche et les réunions des groupes d’intérêt.
La publication dans la série de documents de la SEDI permet aux auteurs de diffuser largement leurs travaux et de toucher un public plus vaste, sans les délais habituels liés aux moyens de publication plus traditionnels. Cette publication n’empêche pas la parution ultérieure des textes dans des revues académiques ou des ouvrages collectifs.
Les éditeurs actuels de la série sont Federica Paddeu et Patryk Labuda. Pour toute demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à esil.papers@gmail.com.
Les articles de la SEDI seront inclus dans le dépôt de recherche EUI CADMUS. Tous les textes présentés lors des événements organisés entre 2021 et 2023 sont accessibles ici.
7. ESIL Book Series
La série de livres de la SEDI publie des volumes de grande qualité sur divers thèmes de droit international. La bonne nouvelle est que le Conseil de la SEDI a élargi la portée de la série de livres de la SEDI, au-delà des thèmes des conférences annuelles de la SEDI et des événements conjoints de la SEDI. Les propositions basées sur les événements du GI et d’autres événements de la SEDI sont les bienvenues. D’autres propositions émanant des membres de la SEDI entrent également dans le cadre de la série de livres. Les éditeurs potentiels sont invités à contacter les éditeurs généraux pour leur soumettre des propositions de volumes édités afin de façonner l’avenir de la publication scientifique de la SEDI.
Les éditeurs généraux sont Christian J. Tams and Machiko Kanetake.
8. ESIL Reflections
‘ESIL Reflections’ offre une analyse périodique de l’actualité et de la pratique du droit international, ainsi que de développements récents dans la doctrine et la théorie du droit international.
Cette publication électronique traite de sujets variés dans un langage accessible aux non-experts, l’objectif étant de stimuler le débat entre membres de la SEDI, experts et praticiens du droit international, en Europe et au-delà. Les ‘ESIL Reflections’ sont publiées sur le site de la SEDI et sont distribuées gratuitement aux membres de la Société.
Les rédacteurs sont Patrycja Grzebyk (rédactrice en chef), Lucas Lixinski, Alina Miron, Anne Saab et Peter-Tobias Stoll.
Les membres de la SEDI souhaitant contribuer aux ‘Reflections’ sont invités à envoyer leurs suggestions à Patrycja Grzebyk.
Dernières publications:
- Does a Doorkeeper Stand Before the Law?: (Non-)Recognition of the Taliban and the HTS Administrations by Muhammed Emre Hayyar
- Ecological Violence Fast and Slow: International Law, Natural Resources in the OPT, and the ICJ Advisory Opinion par Eliana Cusato et Sofia Tamburello
9. Nouvelles de groupes de réflexion
 Les groupes de réflexion (GR) représentent une partie cruciale du succès de la société et de ses activités. Une liste de tous les GR est disponible sur notre site internet.
Les groupes de réflexion (GR) représentent une partie cruciale du succès de la société et de ses activités. Une liste de tous les GR est disponible sur notre site internet.
Les groupes de réflexion organisent des ateliers pré-conférence les 10 et 11 septembre, en amont de la conférence annuelle 2025 de la SEDI à Berlin. Tous les programmes déjà publiés sont disponibles ici .